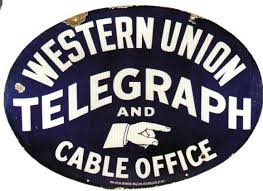Ces Principes ont été édictés le 25 mai 2011 lors de la Réunion ministérielle du 50ème anniversaire de l'OCDE.
Créée en 2001, Sherpa a pour mission de combattre les nouvelles formes d’impunité liées à la mondialisation des échanges économiques et financiers et de défendre les communautés victimes de crimes économiques. Selon ses propres termes, il œuvre pour construire un monde où le droit est au service d’une économie juste.
Il s’agit d’une démarche particulière, car cet accord décrit la manière dont les multinationales doivent agir, alors que ces Principes sont en fait signés par les Etats.
Avec des trous dans la raquette, puisque la Chine, la Russie et l’Inde n’ont pas répondu à l’appel. Ils ne font pas partie de l’OCDE.
Une conduite responsable
L’objectif de l'OCDE est que les entreprises multinationales s’engagent à mener une conduite raisonnable des affaires.
Les champs d’action sont les suivants :
- droits de l'homme,
- environnement,
- fiscalité,
- publication d'informations,
- lutte contre la corruption,
- intérêts des consommateurs, de la science et de la technologie, et de la concurrence.
- les transactions avec des parties liées ;
- les facteurs de risque prévisibles ;
- les questions relatives aux travailleurs et aux autres parties prenantes ;
- les déclarations de principes ou des règles de conduite à l’intention du public, y compris, si leurs activités le justifient, des informations relatives à leurs politiques vis-à-vis des thèmes abordés dans les Principes directeurs ;
- toutes les informations pertinentes ou requises par la loi concernant le choix de la méthode de détermination des prix de transfert adoptée pour les transactions internationales entreprises par elles et par la partie associée.
Respecter le consommateur
Dans le détail, l’OCDE insiste par exemple sur la nécessité de respecter les intérêts des consommateurs.
Donner des renseignements exacts, vérifiables et clairs qui soient suffisants pour permettre aux consommateurs de prendre leurs décisions en connaissance de cause, notamment des renseignements sur les prix et, s’il y a lieu, le contenu, la sécurité d’utilisation, les effets sur l’environnement, l’entretien, le stockage et l’élimination des biens et des services.
Idéalement il est même précisé que ces informations devraient être formulées de manière à permettre aux consommateurs de comparer les produits.
Des lieux de médiation
Néanmoins, il est rappelé que les Principes directeurs sont des instruments non contraignants.
Pourtant, en filigrane, il est aussi précisé qu’ils ont un rôle à jouer pour promouvoir l'observation de ces normes et principes par les entreprises multinationales.
Pour promouvoir les Principes Directeurs, l’OCDE avait prévu la création de Points de contacts Nationaux dans les pays adhérents. En anglais, le terme utilisé est NPC, à savoir National Contact points for Responsible Business Conduct (RBC).
L’action du PCN repose sur un mécanisme volontaire et non judiciaire de règlement des différends en vertu duquel le PCN offre aux parties une plateforme de dialogue (bons offices, médiation) s’il estime que ceci pourrait contribuer favorablement à la résolution des questions soulevées et renforcer l’effectivité des Principes directeurs.
Ces pays sont encouragés à s’appuyer sur les partenaires sociaux, notamment les milieux d’affaires et les organisations représentant les travailleurs, les autres ONG et les autres parties intéressées.
20 ans de recul
Le 20ème anniversaire de ce dispositif est tombé en 2020 : les PCN revendiquent à cette date plus de 500 cas traités, touchant plus de 100 pays et territoires.
Ils ont pu parfois déboucher sur des changements significatifs dans la conduite des affaires, et contribuer à la prévention d’autres dégâts.
- Fin 2020, il existait 50 PCN, le dernier arrivé étant l’Uruguay.
- En 2020, les secteurs les plus concernés sont les activités extractives (24%) devant l’énergie (15%) et la finance (13%).
- Depuis 2000, les points de contacts qui ont été les plus sollicités sont aux Etats-Unis (48), en Grande Bretagne (56) et aux Pays-Bas (39). Le Brésil, le Chili, la France et l’Allemagne figurent aussi dans les pays les plus actifs.
- En 2019, les ONG et les organisations syndicales étaient en tête des procédures. En 2020, ce sont des individus qui ont été les plus actifs. • 38 saisies ont été traitées en 2020 et 54 autres ont été déposées.
Environnement, questions sociales, droits de l’homme
Voici quelques exemples de saisies récentes de PCN :
- En 2020, une coalition internationale de syndicats s’est adressée au PCN néerlandais pour attaquer McDonald's et deux de ses actionnaires, estimant que "la violence et le harcèlement basés sur le genre font partie de la culture" de la chaîne de restaurants.
- En 2017, Greenpeace, Oxfam, Milieudefensie et Banktrack ont porté plainte contre ING devant le PCN néerlandais. Ces ONG dénonçaient le manque de publication des émissions de GES indirectes de la banque, c’est-à-dire celles liées aux projets qu’elle finance. Le PCN s’est saisi volontiers de cette demande. Il indiquait à l’époque que «selon les lignes directrices de l'OCDE, les entreprises doivent faire preuve de diligence raisonnable en ce qui concerne l'impact environnemental. Cela ne concerne pas seulement leur propre impact négatif sur l'environnement, mais aussi l'impact sur leur chaîne de valeur".
- Début 2020, la Société pour les peuples menacés (SPM) a déposé une plainte contre le fournisseur d’électricité suisse BKW auprès du PCN suisse. Cette affaire impliquait BKW et le peuple autochtone des Samis en Norvège. L’ONG suisse affirmait que la perte de ces terres au profit du projet éolien obligerait les derniers éleveurs de rennes samis à renoncer à leurs moyens de subsistance et à leur culture. Cette saisie a conduit BKW à adopter une clause de retrait en cas de violation des droits humains par des tiers.
- Après avoir exercé ses bons offices entre les parties, dont une tentative de médiation, le PCN de Paris a constaté en juillet dernier l’absence d’accord entre UNI Global Union et Téléperformance. Le PCN a publié un communiqué final détaillant sa décision, faisant figurer un rappel au droit des salariés, qui clôture la procédure. Il adresse plusieurs recommandations à la société d’appel téléphonique et annonce qu'il en fera le suivi. Pour Uni et Sherpa, Téléperformance ne répondait pas aux exigences minimales de la loi française sur le devoir de vigilance.
Créée en 2001, Sherpa a pour mission de combattre les nouvelles formes d’impunité liées à la mondialisation des échanges économiques et financiers et de défendre les communautés victimes de crimes économiques. Selon ses propres termes, il œuvre pour construire un monde où le droit est au service d’une économie juste.
Dès 2017, Sherpa a voulu évaluer dans un document de synthèse l’impact des principes directeurs de l’OCDE. Il titrait ce travail « Un statut juridique en mutation ».
En voici un extrait :
La question de la nécessaire et possible mutation des outils de soft law est au cœur de ce débat si contemporain qui associe les Etats, les entreprises et les ONG. Du côté de Sherpa, il y a une volonté de réfléchir, en dehors de tout a priori, aux moyens de parvenir à une sécurité juridique appelée de leurs vœux par tous les acteurs concernés. Un des paradoxes de la soft law et des Principes directeurs en particulier est qu’ils ont été imaginés pour éviter le recours au hard law. Ce que les rédacteurs n’avaient pas prévu c’est leur développement qui entraîne une sortie progressive de leur tutelle de départ à la faveur d’un maillage normatif complété par d’autres outils équivalents. Parmi ces outils, les engagements éthiques des entreprises, devenus un paramètre à part entière de leur activité, contribuent largement à densifier leur statut juridique.
Certains observateurs considèrent que la diligence raisonnable prônée par l’OCDE n’a pas vraiment eu d’impacts décisifs, ce qui aurait finalement conduit au vote d’une loi plus contraignante sur le devoir de vigilance en France et en Allemagne.
Pour aller plus loin :
Responsible business conduct :
Challenge. Mai 2021. Droits humains, environnement... les entreprises de plus en plus sous pression du devoir de vigilance
Liste des pays adhérents aux Principes directeurs de l’OCDE :
Les 36 pays membres de l'OCDE :
Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Chili, Colombie, Corée, Danemark, Espagne, Estonie, États-Unis, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Islande, Irlande, Israël, Italie, Japon, Lettonie, Luxembourg, Mexique, Nouvelle-Zélande, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Turquie.
Les 12 pays adhérents aux Principes Directeurs (non-membres de l'OCDE) :
Argentine (1997), Brésil (1997), Costa Rica (2013), Égypte (2007), Jordanie (2013), Kazakhstan (2017), Lituanie (2001), Maroc (2009), Pérou (2008), Roumanie (2005), Tunisie (2012), Ukraine (2017).
Les Echos solutions. Mai 2011 « Diligence raisonnable » obligatoire dans l’UE : une avancée prometteuse pour les entreprises
Octobre 2011. L’industrie extractive se terre encore au fond de la mine